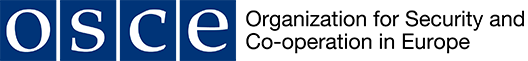L’élaboration de l’Acte final de Helsinki vue de Belgrade
L’élaboration de l’Acte final de Helsinki vue de Belgrade
Lorsque la première phase de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe s’est terminée à Helsinki en juillet 1973, tout le monde savait qu’un premier pas historique avait été franchi pour mettre fin à la guerre froide. Mais l’Acte final de Helsinki n’existait pas encore. L’accord, qui est devenu la pierre angulaire de la sécurité européenne, a été élaboré au cours de la deuxième phase de la Conférence, non pas en Finlande, mais à Genève, en Suisse, du 18 septembre 1973 au 1er août 1975.
C’était une nouvelle expérience dans le domaine des relations internationales. En vertu des dispositions de procédure de la Conférence, chaque pays disposait d’une voix égale et d’un droit de veto. Plusieurs milliers de propositions avaient été faites. L’Est et l’Ouest étaient en concurrence pour faire accepter leurs positions. Les États neutres et non alignés servaient de médiateurs, mais défendaient également leurs propres causes.
Vladimir Bilandzic était, à l’époque, jeune chercheur en politique internationale et en économie à Belgrade. Il a rejoint la délégation de la Yougoslavie aux négociations de Genève comme expert en questions de sécurité internationale pour la majeure partie de la deuxième année. Il se souvient de la dynamique des négociations et du souci particulier de la Yougoslavie de donner une « dimension mondiale » à l’accord sur la sécurité européenne.
Comment les réunions de Genève étaient-elles organisées ?
Les réunions ont eu lieu dans un premier temps à la Villa Moynier, à proximité du Palais des Nations, puis dans les locaux de l’Organisation internationale du Travail, et enfin au nouveau Centre international de conférences de Genève. C’était réellement un mélange de rencontres formelles et informelles. Les plénières se tenaient une fois par semaine même si, par la suite, alors que les négociations touchaient à leur fin, elles ont eu lieu plus fréquemment car les chefs de délégation devaient parvenir à des compromis sur les parties les plus contestées du texte.
Des réunions de commissions se sont tenues pour chacune des trois corbeilles, sur la sécurité et les principes fondamentaux régissant les relations entre États (le « Décalogue de Helsinki »), sur les questions économiques et environnementales et sur les questions humanitaires. Des groupes de travail ad hoc ont aussi été constitués, par exemple sur la région méditerranéenne et sur le non recours à la force. De longues pauses café, mises à profit en fait pour des négociations informelles et bilatérales, avaient également lieu.
Bien souvent, au cours du dernier mois, en juin 1975, les pourparlers se prolongeaient jusque tard dans la nuit. Mais, avant l’été en question, il y avait aussi eu des périodes durant lesquelles le rythme était moins soutenu. D’autres événements sur la scène internationale – la fin de la guerre du Vietnam, par exemple – ont, bien entendu, influé sur les négociations, mais ces dernières se sont poursuivies sans être entravées par ces développements de plus grande ampleur.
Il y avait, en substance, trois groupes d’États, à savoir les États occidentaux, l’Union soviétique et les membres du Pacte de Varsovie, et les États neutres et non alignés. Ce dernier groupe était composé de quatre États neutres plus la Yougoslavie, auxquels sont venus s’ajouter par la suite Malte et Chypre. L’Irlande était certes également neutre, mais ne faisait pas partie de ce groupe.
Quel était le rôle du groupe des pays neutres et non alignés ?
Au début, il avait essentiellement un rôle de médiation et s’efforçait de trouver un terrain d’entente entre les deux blocs. Par la suite, cependant, le groupe a aussi exposé ses propres intérêts et formulé des propositions, dont une sur les mesures de confiance.
Un processus avait été adopté au sein de ce groupe hétérogène pour s’accorder sur des positions communes. Au début, les domaines d’intérêt commun se limitaient principalement à la sécurité militaire et d’autres questions similaires avant de voir leur nombre augmenter par la suite. Quelques pays, dont l’Autriche, la Suisse et la Suède, par exemple, ont joué un rôle de premier plan en matière de droits de l’homme. À l’époque, la Yougoslavie n’était pas un pays démocratique doté d’un système multipartite et ne pouvait pas aller aussi loin que d’autres. Certains éléments, notamment les droits des minorités nationales, faisaient cependant l’objet d’un consensus.
La Yougoslavie s’employait à promouvoir ce que l’on avait coutume d’appeler à l’époque la « dimension mondiale ». Elle insistait sur le fait que l’on ne pouvait pas dissocier la sécurité en Europe de celle des autres régions, que l’Europe ne devait pas être considérée comme un îlot de civilité alors que le reste du monde était insuffisamment développé et en proie à des conflits. Elle a donc plaidé en faveur de la prise en compte de cette « dimension mondiale » ou, en d’autres termes, d’une approche globale dans le texte de l’Acte final de Helsinki. Des formulations allant dans ce sens ont effectivement été intégrées dans certaines des dispositions du document. Dans l’introduction à la Déclaration sur les principes régissant les relations mutuelles des États participants, par exemple, ces derniers se sont déclarés conscients « de la nécessité pour chacun d’entre eux d’apporter sa contribution au renforcement de la paix et de la sécurité mondiales ». Et, dans le Principe IX (Coopération entre les États), il est dit ceci : « ils prennent en considération l’intérêt de tous dans la réduction des différences entre les niveaux de développement économique, et notamment l’intérêt des pays en voie de développement du monde entier. » On trouvera un autre exemple dans la partie traitant des questions relatives au désarmement, dans laquelle il est dit que les États participants sont convaincus que des mesures effectives dans ce domaine « devaient aboutir au renforcement de la paix et de la sécurité dans le monde. »
Bien entendu, après la chute du mur de Berlin et l’évolution ultérieure de la situation en Europe avec la dissolution de la Yougoslavie et l’élargissement de l’Union européenne, tout cela a changé. Mais je crois qu’il reste intéressant d’analyser la dynamique des négociations menées à l’époque.
Comment les négociations se déroulaient-elles concrètement ?
La règle générale était que, dans le texte de l’Acte final de Helsinki, « rien n’est convenu jusqu’à ce que tout ait été convenu. ». C’est la formule qui a toujours été utilisée. Théoriquement, il aurait suffi qu’un seul paragraphe ne soit pas adopté pour que l’ensemble du document soit considéré comme non approuvé. C’est réellement la démarche qui a été suivie.
Le recours aux parenthèses était très fréquent dans le texte. Si des délégations constataient qu’un accord n’était pas parvenu sur une partie donnée du texte, dans le souci de ne pas bloquer les négociations, elles déclaraient simplement ceci : « mettons cette partie entre parenthèses, poursuivons notre travail et revenons-y plus tard. » Cette façon d’utiliser les parenthèses a été maîtrisée presque à la perfection : à un moment donné, il y avait plus de texte entre parenthèses qu’en dehors de celles-ci. Parfois, la discussion portait sur la question de savoir si les phrases devaient comporter des virgules ; ce fut le cas s’agissant du principe de l’inviolabilité des frontières et de la possibilité de les modifier par des moyens pacifiques. Et, alors que les négociations touchaient à leur fin, la question des différentes versions linguistiques et de la traduction de l’anglais, langue de rédaction, en russe, en allemand, en français, en italien et en espagnol s’est posée. Certaines délégations craignaient qu’un engagement qui paraissait clair en anglais ne le soit pas autant dans d’autres langues.
Les négociations ont été très complexes. Certaines parties du document étaient subordonnées à d’autres. Pour parvenir à obtenir un consensus sur une phrase ou un principe, il fallait en même temps se mettre d’accord sur une autre phrase ou un autre principe. Des accords dits globaux, s’appliquant même à des corbeilles différentes, étaient fréquents.
Il a été fait un usage strict de la règle du consensus, laquelle a été bien respectée. N’importe quelle délégation, y compris celle qui représentait le plus petit pays, pouvait retarder ou bloquer une décision. C’est ce qui s’est passé tout à la fin. Alors que l’ensemble du texte de l’Acte final de Helsinki était approuvé, Malte a tenu à une formulation donnée s’agissant de la Méditerranée et a bloqué la conférence pendant presque deux jours jusqu’à ce qu’un compromis ait pu être trouvé. Cela avait fait la une de tous les journaux à l’époque.
L’horloge a, par ailleurs, été utilisée de manière créative le dernier soir des négociations alors que minuit, heure limite pour l’approbation du texte de l’Acte final de Helsinki, avait déjà sonné. L’horloge a été arrêtée dans la salle de conférence et les participants sont convenus que le texte avait été finalisé dans les délais impartis.
Aujourd’hui, deux ans pour négocier un document peut sembler particulièrement long, mais n’oublions pas que, pour l’Acte final de Helsinki, nous sommes partis d’une page presque blanche. Les principes de base avaient déjà été convenus à Helsinki, au cours de la Réunion préparatoire, mais pas le texte proprement dit. Deux années de négociation, ce n’est pas si long que ça, je crois, pour un texte de l’importance de l’Acte final de Helsinki.
Quels sont, selon-vous, les points communs entre les négociations à l’époque et aujourd’hui à l’OSCE ?
La règle du consensus était la règle suprême à l’époque et elle l’est toujours ; cela n’a pas changé. Aujourd’hui, malgré toutes les difficultés, l’Europe est à l’évidence beaucoup plus unie qu’elle ne l’était. À l’époque, il y avait un fort sentiment que des perspectives nouvelles s’ouvraient dans le domaine des relations internationales. Les États participants aspiraient à élaborer un document qui permettrait de renforcer la sécurité en Europe et personne ne voulait prendre le risque d’un échec de l’accord. Rétrospectivement, je crois donc que la conférence ne pouvait que réussir. Mais cela n’a pas été facile. Les systèmes politiques étaient très différents à l’époque et les systèmes de valeurs également.
Il y avait peut-être une tendance à prendre les choses, je n’irais pas jusqu’à dire plus sérieusement à l’époque, mais les mots avaient beaucoup d’importance. Chaque phrase était analysée. C’était un exercice courant, mais aussi en quelque sorte un duel entre les deux parties pour faire prévaloir leurs intérêts. C’était en outre une rivalité idéologique et, dans certains milieux, cet exercice suscitait des doutes. Il fallait donc convaincre nos représentants dans les capitales, nos concitoyens, de l’intérêt de tout ce processus.
Tous les éléments de l’OSCE telle que nous la connaissons aujourd’hui ont été inclus, d’une manière ou d’une autre, dans l’Acte final de Helsinki. De nombreuses dispositions opérationnelles ne sont plus pertinentes, mais les principes de base restent valables et les valeurs fondamentales, comme les droits de l’homme et l’égalité souveraine des États, demeurent légitimes, dans une large mesure, pour le règlement pacifique des différends. Les mesures de confiance et de sécurité militaires, qui étaient certes modestes par rapport à ce qu’elles sont aujourd’hui, ont constitué une percée car, pour la première fois, les pays s’étaient engagés à annoncer leurs manœuvres militaires à l’avance afin d’éviter les malentendus et de réduire les risques.
Bien entendu, un des points les plus importants, sans quoi l’OSCE ne serait pas devenue l’organisation internationale qu’elle est aujourd’hui, était qu’il avait été convenu de poursuivre le processus. Au début de la conférence, il n’était pas garanti que tous les États seraient disposés à aller dans ce sens. Certains étaient d’avis que l’Acte final de Helsinki devrait marquer la fin du processus. Mais, en fait, il avait été décidé d’organiser une réunion de suivi à Belgrade. Pourquoi Belgrade ? La Yougoslavie était membre du groupe des pays neutres et non alignés et n’avait pas encore accueilli de réunion (comme l’avaient fait la Suisse et la Finlande). Par ailleurs, elle était très active au sein du mouvement des pays non alignés aux Nations Unies et elle entretenait à l’époque des liens solides avec la région méditerranéenne. Les négociations de Genève concernant l’Acte final de Helsinki étaient donc un début, plutôt qu’une fin, ce qui est, je crois, des plus importants.
Après la signature de l’Acte final de Helsinki, Vladimir Bilandzic a participé aux réunions de suivi de la CSCE et aux négociations relatives aux mesures de confiance et de sécurité (MDCS). Il est aujourd’hui Conseiller spécial pour les MDCS à la Mission de l’OSCE en Serbie.
Lectures complémentaires
Pour un compte rendu détaillé du processus de la CSCE rédigé par un participant de l’ex‑Yougoslavie, lire l’ouvrage Problems of Security and Cooperation in Europe de Ljubivoje Aćimović (Sijthoff & Noordhoff, 1981). Première publication en serbo-croate sous le titre Problemi bezbednosti i saradnje u Evropi.
Cet article est le troisième d’une série d’articles consacrés à l’Acte final de Helsinki publiés dans Communauté de sécurité à l’occasion du quarantième anniversaire de ce document fondamental de l’OSCE. Lire aussi : « Raviver l’esprit de Helsinki » par Lamberto Zannier (numéro 1/2015) et « Qu’advient-il de la deuxième dimension ? » par Kurt P. Tudyka (numéro 2/2015).
Discutons-en!
Votre avis
Vos commentaires sur les questions de la sécurité sont les bienvenus. Une sélection de commentaires sera publiée. Envoyez les à: [email protected]
Contributions
Les contributions écrites sur les aspects de la sécurité politico-militaire, économique et environnementale ou humaine sont bienvenus. Les textes peuvent être soumis à modification éditoriale. Contactez [email protected]