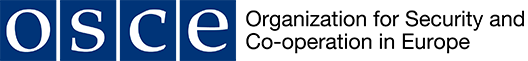Comment l’enseignement de l’histoire peut-il changer le monde d’aujourd’hui ?
Dans la dernière partie des Recommandations de La Haye, consacrée à l’élaboration des programmes d’études, les États sont invités à veiller à ce que l’histoire, la culture et les traditions de leurs minorités nationales soient enseignées à l’école. C’est précisément à cette tâche que se sont attelées, dès 1992, Joke van der Leeuw-Roord et l’Association européenne des professeurs d’histoire (EUROCLIO), organisation qu’elle a créée.
Quel est l’objectif d’EUROCLIO ?
EUROCLIO réunit des personnes chargées de transmettre aux jeunes de la génération suivante leur histoire et leur héritage culturel. Nous travaillons dans de nombreux pays d’Europe et au-delà, en particulier dans ceux qui ont connu des tensions inter-ethniques ou des conflits violents récemment. Nous créons des réseaux visant à promouvoir une approche inclusive de l’histoire. Dans certains pays, nous travaillons essentiellement avec des professeurs d’histoire, dans d’autres avec des universitaires et des muséologues. En Bosnie‑Herzégovine, par exemple, le groupe avec lequel nous travaillons est assez hétérogène, composé pour la plupart d’historiens qui étaient des jeunes gens après la guerre, tous animés d’une volonté commune d’empêcher que les horreurs du passé ne s’inscrivent dans le présent. Il est impressionnant de voir comment ils sont parvenus à accorder leur peine personnelle à une solide démarche professionnelle.
Outre la création de réseaux, nous offrons des possibilités de développement professionnel et essayons de susciter chez les éducateurs un engagement en faveur d’un apprentissage perpétuel. Troisièmement, nous nous intéressons aux outils pédagogiques. En tant que professeurs d’histoire, nous nous demandons comment faire pour enseigner l’histoire de manière responsable, en évitant de nous appesantir trop sur certains sujets et pas assez sur d’autres, et comment faire pour rendre l’enseignement de l’histoire attractif. Notre ambition est de faire de l’histoire une discipline dont les étudiants pourront dire qu’elle leur a apporté quelque chose pour le restant de leurs jours.
Comment est née EUROCLIO ?
En 1991, le Conseil de l’Europe a organisé la première réunion pan-européenne sur l’enseignement de l’histoire après la chute du mur de Berlin. J’y avais été envoyée par mon gouvernement en ma qualité de présidente de l’Association néerlandaise des professeurs d’histoire. Le premier soir, le directeur de l’éducation au Conseil de l’Europe, à côté duquel j’étais assise, se tourna vers moi et me dit : « Le fait est, nous travaillons avec les gouvernements depuis si longtemps déjà, depuis la fin des années 40, mais en réalité si peu a été accompli sur le terrain. Pouvez-vous essayer de mettre en place une organisation qui travaille avec ceux-là mêmes qui enseignent l’histoire ? » J’ai grandi absolument avec le spectre de la seconde guerre mondiale et de la guerre froide, et la chute du mur de Berlin a été une expérience personnelle marquante. Aussi cette demande a-t-elle réellement fait écho chez moi et je me suis dit : « OK, je vais essayer ! ». J’ai commencé aussitôt, pendant la conférence, à aller à la rencontre de gens et à leur demander s’ils représentaient une association. N’oubliez pas que c’était l’époque d’avant l’Internet, il fallait donc prendre les adresses sur des bouts de papier. Mais, curieusement, en une année, nous avions 17 organisations qui avaient répondu qu’elles étaient d’accord pour travailler ensemble.
Quels enseignements avez-vous retiré de cette coopération?
Dès cette première année, il s’est produit un incident révélateur majeur. Au début, on ne parlait que de ces « pauvres gens venus de l’Est » et du fait que nous devions absolument les aider à bien appréhender l’histoire. Mais ensuite, nous avons commencé à nous rendre compte que nos collègues des pays de l’ancien bloc de l’Est n’étaient pas les seuls à avoir été en proie à des préjugés politiques. L’incident révélateur, c’est lorsque l’un de nos premiers membres, président d’une organisation flamande, a été interpelé par les communistes s’exclamant : « Mais vous avez eu ces grandes journées révolutionnaires en 1918 !» et lui de répondre : « Non, ce n’est pas exact ! ». Trois semaines plus tard, il m’appelle : « Joke, c’est tout à fait exact – et on n’en a jamais entendu parler. C’est complètement passé sous silence dans l’histoire qu’on nous enseigne ! »
C’est ainsi que nous nous sommes rendus compte qu’en fait, nous fonctionnons tous dans un cadre politique donné et que l’on peut trouver un schéma de préjugés dans tous les pays, dans toutes les communautés. En travaillant ensemble, nous avons appris à reconnaître ce schéma, et notre défi a alors été d’empêcher qu’il ne soit utilisé à tort. La première composante de ce schéma est la fierté. On est fier de son histoire. Un Britannique, par exemple, vous dira qu’en Grande-Bretagne, être fier de l’histoire de son pays prime avant tout. La deuxième composante est la victimisation. Et si vous êtes un pays comme l’Estonie, c’est ce sentiment qui primera. Les deux premières composantes dépendent donc, dans une certaine mesure, de la place qu’occupe votre pays dans un contexte historique plus large. La troisième composante est : « Le tort commis envers autrui est toujours caché sous le tapis ; c’est très dur de le reconnaître. » Enfin, la dernière composante : « Tout ce qui n’est pas relié à notre propre histoire ne nous concerne pas. ». De sorte que si vous vivez aux Pays-Bas, vous ne connaissez rien de la Norvège ou de l’Afrique, sauf s’il y a eu un lien de caractère colonial.
Quels sont quelques-uns des obstacles concrets auxquels vous vous êtes heurtés ?
La complémentarité des champs de compétences pour mettre sur pied un projet est une des difficultés à laquelle nous nous sommes heurtés presque partout. Des gens valables, vous en trouvez sans difficulté, mais le problème commence avec l’équilibre hommes/femmes. Lorsque des experts se réunissent, ce ne sont généralement que des hommes or, dans l’enseignement, ce ne sont bien souvent que des femmes ! En outre, dans les pays fortement attachés à l’indépendance, comme la Géorgie, l’Ukraine, la Lettonie et l’Estonie, il n’est pas rare que le groupe ne soit pas vraiment représentatif de l’ensemble de la population. En Lettonie ou en Estonie, par exemple, une grande partie de la population est russisante, et nous voulons travailler avec ces gens-là aussi. Mais tout de suite, le problème de la langue se pose. C’est ainsi qu’à la fin des années 90, les membres d’un groupe de travail en Estonie nous ont dit qu’ils ne voulaient pas communiquer entre eux en russe. Nous avons alors décidé de prendre un anglophone au sein de la communauté russisante. Or il s’est avéré que savoir parler anglais ne fait pas nécessairement un bon professeur d’histoire. Finalement, après beaucoup de résistance d’ordre émotionnel, le groupe est parvenu à faire passer l’intérêt d’avoir des cours de qualité avant celui de communiquer dans leur langue.
L’obligation de prendre en compte les préférences des donateurs représente aussi un défi. Un grand nombre de nos projets se trouvent dans les anciens pays d’Europe de l’Est, car c’est là que le financement est disponible, même s’il y a du travail important à faire en Europe de l’Ouest également, comme on ne s’en aperçoit que trop aujourd’hui. Les donateurs ne voient pas toujours la situation dans son ensemble. De plus, les spécifications des projets exigent souvent l’inclusion d’un certain nombre de pays, même dans les cas où, selon nous, il serait probablement plus judicieux de commencer avec un projet local afin de développer les compétences dans l’enseignement de l’histoire, de la citoyenneté et du patrimoine.
Quelles sont les principales réalisations d’EUROCLIO ?
La véritable force d’Euroclio, c’est de mettre en place des organisations issues de la société civile : nous en avons à présent plus de 70 dans 55 pays. Nous avons formé des milliers de membres et nombre d’entre eux ont terminé leur carrière à des postes clés dans le système politique ou éducatif de leur pays. Qu’ils soient devenus des professeurs, des penseurs ou des historiens, ils ont acquis véritablement la capacité de s’interroger sur l’histoire, bien plus que ce qu’on leur a jamais appris à l’école ou à l’université il y a dix ou vingt ans.
L’histoire est toujours une question de perspective. En particulier dans les Balkans, les frontières tracées par les nationalistes se recoupent beaucoup. Il y a toujours un moment dans l’histoire où vous pouvez tracer une ligne et dire : « C’est tout à nous ». Nous essayons de faire réfléchir les gens là-dessus. Mais ce n’est pas seulement les Balkans. On les dépeint toujours comme les méchants. La perception qu’ont les Allemands, les Belges ou les Néerlandais de leurs frontières s’est aussi modifiée, simplement pas au même moment dans l’histoire. Il est capital pour nous en Europe de l’Ouest de ne pas nous profiler comme les pays civilisés qui apprivoisent les contrées sauvages – c’est trop primitif de penser de la sorte.
Beaucoup de la recherche que nous devons mener pour être capable de voir les choses du point de vue de l’autre reste encore à faire. Je dis toujours aux historiens : « Cherchez des domaines de recherche qui soient importants même s’ils ne sont peut-être pas si à la mode ! ». Nous avons réellement besoin de travailler sur des faits solides. L’histoire est une question d’interprétation, encore faut-il qu’elle s’appuie sur des faits.
Joke van der Leeuw-Roord, experte renommée en éducation, méthodologie innovante et histoire transnationale, est la fondatrice et conseillère spéciale de l’Association européenne des professeurs d'Histoire (EUROCLIO).
Discutons-en!
Votre avis
Vos commentaires sur les questions de la sécurité sont les bienvenus. Une sélection de commentaires sera publiée. Envoyez les à: [email protected]
Contributions
Les contributions écrites sur les aspects de la sécurité politico-militaire, économique et environnementale ou humaine sont bienvenus. Les textes peuvent être soumis à modification éditoriale. Contactez [email protected]